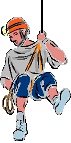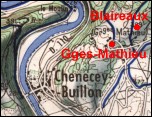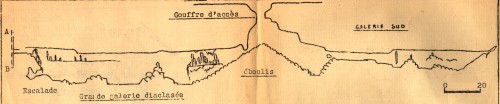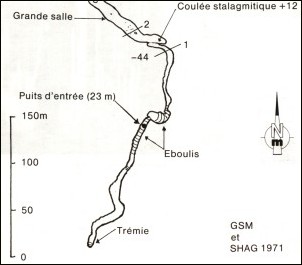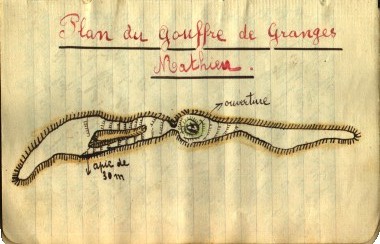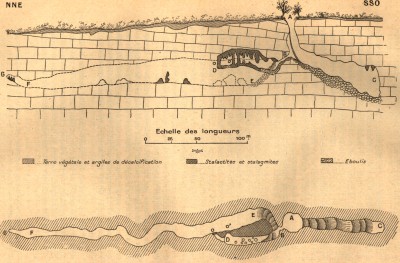|

|

|
|
 Gouffre
des Granges-Mathieu Gouffre
des Granges-Mathieu
|
ou
gouffre à Dédé
|
|
|
|
Chenecey-Buillon
(Doubs)
Coordonnées Lambert : 875,64 - 244,83 - 387
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
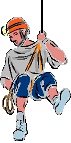
|
 Exploration
Exploration
 Le gouffre des Granges-Mathieu est le lieu
privilégié des premières explorations
rapportées dans les carnets.
Le gouffre des Granges-Mathieu est le lieu
privilégié des premières explorations
rapportées dans les carnets.
En 1916, les frères Duret et leur équipe l'ont
visité à quatre reprises, les 19 mars
(n°1),
23 mars (n°2),
26 mars (n°3)
et 27 avril (n°7).
Ont participé à ces séances :
Billey, Challe, Derrier, Duret Marcel, Duret Robert, Flusin
André, Flusin Robert, Foret Jacques, Foret Max, Laloy
Paul, Laloy R., Lecreux P., Martin André, Martin
Léonce et Zeller Robert.
Quelques-uns d'entre eux y sont revenus pour diriger une
excursion collective, le 11 mars 1917 (n°15),
jour de l'accident mortel d'Emile Andlauer.
 Le gouffre des Granges-Mathieu est en fait exploré
partiellement depuis longtemps. R.Duret signale avoir
découvert des inscriptions datant de 1886, dans la
galerie sud, ainsi qu'un "billet dans une fente de rocher",
où "est écrit le nom d'un soldat du
Cinquième d'artillerie" (compte-rendu du
19 mars
1916).
Le gouffre des Granges-Mathieu est en fait exploré
partiellement depuis longtemps. R.Duret signale avoir
découvert des inscriptions datant de 1886, dans la
galerie sud, ainsi qu'un "billet dans une fente de rocher",
où "est écrit le nom d'un soldat du
Cinquième d'artillerie" (compte-rendu du
19 mars
1916).
E. Fournier, quant à lui, l'a exploré en
mai 1907, sur une quarantaine de mètres dans la
galerie sud, et jusqu'à la base de la coulée
stalagmitique, à 120 m du puits, dans la galerie
nord (voir
ci-dessous).
C'est en 1956 qu'une équipe interclub (Groupes
Spéléo du Doubs, de Belfort et de St-Dizier)
escalade la coulée de la galerie nord et explore le
reste de la cavité, soit environ 950 m.
 La visite de l'équipe Duret, en 1916, constitue en
partie une première : en effet, dans la galerie
sud, la barrière de blocs que Fournier n'avait pas
escaladée est franchie, et une centaine de
mètres de galerie explorés au-delà.
La visite de l'équipe Duret, en 1916, constitue en
partie une première : en effet, dans la galerie
sud, la barrière de blocs que Fournier n'avait pas
escaladée est franchie, et une centaine de
mètres de galerie explorés au-delà.
D'autre part, comme c'est souvent le cas, Duret fournit des
cotes et des observations plus proches de la
réalité que Fournier, très fantaisiste
dans ses descriptions.
Quelques exemples :
- le puits d'entrée, qui mesure 23 m, est
donné pour 35 m par Fournier, et pour 30 m
par Duret.
- la galerie sud n'a été vue que sur 40 m
par Fournier, qui lui attribue 70 m (mesuré sur
son plan) pour une profondeur de 65 à 70 m...
chiffres exagérés, sachant que la cote
réelle est de -42 m.
Quant à
l'équipe Duret, qui a exploré cette galerie
sur 150 m pour -42 m, sa topographie indique 190m
pour -45 m, ce qui est une approximation
acceptable.
- la galerie nord est donnée pour 300 m et -60
par Fournier, et pour 150 m par Duret, alors que ses
cotes réelles sont de 120 m pour -44. Là
encore, les écrits de Duret sont plus rigoureux que
ceux de Fournier.
Enfin, l'hypohèse de Duret sur une jonction possible
entre la grotte aux Blaireaux et le gouffre de Granges
Mathieu est inédite. Elle sera reprise par E.Fournier
dans sa publication de 1923, alors qu'elle ne figurait pas
dans son article de 1907.
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|

|
 Description
Description
|
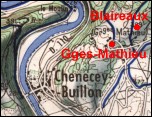
|

|
 Le gouffre débute par un large puits profond
de 23 m, formant un regard sur une galerie
concrétionnée. A sa base, un
cône d'éboulis conduit, d'une part,
à la branche sud terminée 150 m
plus loin par une trémie et, d'autre part,
à la branche nord où on parvient, au
bout de 120 m, au pied d'une coulée
stalagmitique (-44), constituant le terminus
jusqu'en 1956.
Le gouffre débute par un large puits profond
de 23 m, formant un regard sur une galerie
concrétionnée. A sa base, un
cône d'éboulis conduit, d'une part,
à la branche sud terminée 150 m
plus loin par une trémie et, d'autre part,
à la branche nord où on parvient, au
bout de 120 m, au pied d'une coulée
stalagmitique (-44), constituant le terminus
jusqu'en 1956.
Une escalade de 12 m sur cette coulée
donne accès à la suite de la
cavité, qui se prolonge sur 900 m vers
le nord.
 Développement : 1173 m -
Dénivellation : -44 m
Développement : 1173 m -
Dénivellation : -44 m
|
|
|
|
|
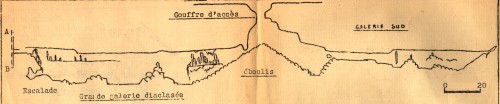
|
|
|
|
Coupe
partielle, d'après Mauer R., 1959, Nos Cavernes,
bulletin du Groupe Spéléologique du Doubs,
n°6, p.12
|
|
|
|
|
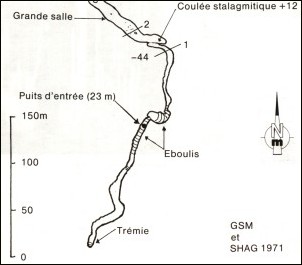
|

|
Plan
partiel, d'après :
Inventaire Spéléologique
du Doubs
(Comité Départemental
de Spéléologie du Doubs)
tome 2-1991, p.191
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|

|
 Topographie Duret
Topographie Duret
|
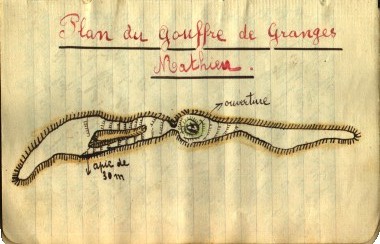
|
Plan
complet du gouffre des Granges-Mathieu (parties
connues à l'époque). Ce croquis
reprend ceux des 23
et 26 mars
1916.
Duret y a ajouté le passage supérieur
aboutissant dans les voûtes de la galerie
nord (à gauche sur le dessin),
itinéraire emprunté par Emile
Andlauer, avant sa chute mortelle.
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|

|
 Extrait de : Fournier E., 1907, Spelunca, bull. et
mém. Soc. de Spéléologie, n°50,
p.102-104
Extrait de : Fournier E., 1907, Spelunca, bull. et
mém. Soc. de Spéléologie, n°50,
p.102-104
|
|
|
|
|
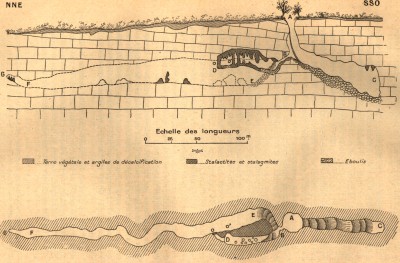
|

|
"Aux
Granges Mathieu, près de Chenecey-Buillon,
s'ouvre un gouffre important, au fond duquel,
d'après le dire des gens du pays, devait
exister une importance rivière
souterrain.
Grâce à l'obligeance de M. Magnin, de
Moncey, qui a bien voulu mettre à notre
disposition son automobile, nous avons pu accomplir
l'exploration de cette intéressante
cavité. Le gouffre (A), qui forme
l'entrée de la grotte, mesure 35
mètres de profondeur verticale et aboutit
à un talus d'éboulis B C, en pente
très forte, qui amène à une
profondeur totale d'environ 65 à 70
mètres, de la surface. Cette première
galerie se termine en cul-de-sac, mais elle est
remarquable par les belles dimensions de sa
voûte, qui, vue du fond,
éclairée d'en haut par le gouffre,
est d'un effet grandiose.
|
On
a jeté autrefois beaucoup de bêtes mortes dans
ce gouffre, comme le témoignent les très
nombreux ossements qui, avec des débris divers de
ferraille et d'ustensiles de ménage, constituent une
grande partie du talus d'éboulis.
Dans la paroi B du gouffre, s'ouvre un orifice juste assez
grand pour y introduire le corps et qui menace même de
se fermer un jour ou l'autre par le glissement des
éboulis ; cet orifice donne accès dans une
première galerie B D, remarquable par ses superbes
stalactites et stalagmites. Vers le fond de la galerie B D,
deux orifices 0 et 0', aboutissent à des à pic
donnant dans la galerie principale ; mais, il n'est pas
nécessaire de franchir ces à pic, pour
pénétrer dans cette galerie, car, si l'on
revient vers l'ouverture B, on petit suivre un talus
d'éboulis B E, qui permet d'y accéder
directement. Cette grande galerie E F G, mesure environ 300
mètres de longueur totale ; elle est peu sinueuse, et
renferme des rochers éboulés et quelques
stalagmites.
Elle se termine par un petit cul-de-sac ascendant G. Lorsque
nous l'avons explorée, en compagnie de M. Magnin, de
Moncey, elle était à sec, mais, en temps de
pluie, les eaux y circulent très certainement. Ces
eaux rejoignent, par des fissures du calcaire, celles qui
alimentent la résurgence qui jaillit sur la rive
droite de la Loue, au-dessous de la Grotte de Chenecey que
nous avons décrite ici naguère.
Au total les galeries du gouffre-grotte des Granges Mathieu,
dépassent 450 mètres de longueur, et sont
particulièrement remarquables au point de vue
pittoresque : malheureusement l'aménagement en serait
assez coûteux et, de plus, cette cavité se
trouve située un peu en dehors des moyens commodes de
communication."
|
|
|
|
 Extrait de : Fournier E., 1923, Explorations souterraines en
Franche-Comté - Les gouffres, p.49-52
Extrait de : Fournier E., 1923, Explorations souterraines en
Franche-Comté - Les gouffres, p.49-52
|
|
|
|
"Près
du hameau des Granges-Mathieu, au nord-est de
Chenecey-Buillon, s'ouvre, dans le Bathonien moyen, un
gouffre au fond duquel passait, d'après les
légendes locales, une rivière souterraine
alimentant la source située au-dessous de la grotte.
Dès 1903, on nous avait signalé cet
abîme ; des soldats en manoeuvres y étaient,
disait-on, descendus et avaient constaté l'existence
de belles galeries. En mai 1907, nous avons pu faire
l'exploration complète de cette intéressante
cavité. L'entrée constitue un sorte
d'entonnoir garni d'arbres, qui se continue par un gouffre
vertical. A 35 mètres environ de profondeur, nous
prenons pied sur un talus d'éboulis, B C, qui descend
en pente très forte jusqu'à une profondeur
d'environ 65 à 70 mètres au-dessous de la
surface. Cette première galerie se termine en
cul-de-sac, mais elle est remarquable par sa belle
voûte qui, vue du fond, éclairée d'en
haut par le gouffre, est d'un effet imposant. On a
jeté autrefois beaucoup de bêtes mortes dans
cet abîme, comme en témoignent les nombreux
ossements qui, mélangés à divers
débris de ferraille et de vieux ustensiles de
ménage, constituent une partie du talus
d'éboulis.
Dans la paroi B du gouffre, s'ouvre un orifice juste assez
grand pour y introduire le corps et qui menace même
d'être obstrué un jour ou l'autre par le
glissement des éboulis : cet orifice donne
accès dans une première galerie, B D,
remarquable par ses superbes stalactites et stalagmites et
mesurant une cinquantaine de mètres de longueur. Vers
le fond de cette galerie, deux orifices, 0 et 0', s'ouvrent
sur un à-pic d'environ 25 mètres, donnant
accès dans la galerie principale E F G; mais il n'est
pas nécessaire de franchir cet à pic, car, si
l'on revient vers l'ouverture B, on peut, en descendant sur
un talus d'éboulis B E, accéder directement
dans la galerie E F G. Cette galerie a une longueur
d'environ 300 mètres ; ses voûtes sont
élevées dans toute la première
moitié du parcours et s'abaissent progressivement
jusqu'à l'extrémité F G,
constituée par un petit cul-de-sac ascendant, garni
de stalagmites. Lorsque nous avons exploré cette
galerie, en compagnie de M. Magnin de Moncey, elle
était à sec ; mais, pendant les
périodes humides, les eaux y circulent très
certainement, et c'est sans doute ce qui a pu faire croire
à l'existence d'une rivière souterraine
permanente. Ces eaux rejoignent, par des fissures du
calcaire, celles qui alimentent la résurgence qui
jaillit sur la rive droite de la Loue, au-dessous de la
Grotte de Chenecey. Au total, la longueur des galeries du
Gouffre-Grotte des Granges-Mathieu dépasse 450
mètres. Ces galeries, qui sont
particulièrement remarquables, au point de vue
pittoresque, se rattachent, sans aucun doute, au même
réseau que la Grotte, avec laquelle il serait
même peut-être possible d'établir une
communication, en procédant à des travaux de
désobstruction; ce serait là un moyen de
réaliser un aménagement parfait du gouffre,
sans avoir recours à un escalier de descente, dont la
construction serait coûteuse ; l'ensemble des deux
cavités constituerait alors une attraction
touristique de premier ordre.
L'exploration du Gouffre de Granges-Mathieu fut
renouvelée par MM. Guillin, préparateur de
physique à la Faculté, et Rimey,
étudiant, le 30 juin 1907, et, depuis lors, des
descentes ont été effectuées à
diverses reprises par de nombreux excursionnistes. Bien
qu'il ne présente aucun danger et soit même un
des plus faciles d'accès de toute la région,
cet abîme a été récemment (11
mars 1917) le théâtre d'un accident tragique.
Plusieurs excursionnistes de Besançon étaient
en train de visiter le gouffre, lorsque M. Andlauer,
professeur à l'Institution Saint-Jean, voulut se
faire descendre pour aller rejoindre les excursionnistes qui
se trouvaient dans la galerie du fond ; il entra dans la
galerie B D et, trompé sans doute par
l'obscurité, s'engagea dans l'orifice 0', perdit
l'équilibre et vint se fracasser le crâne, 25
mètres plus bas, sur les rochers qui, en cet endroit,
garnissent le fond de la galerie inférieure ; la mort
fut instantanée. Ce déplorable accident
confirme une fois de plus que, lorsqu'on
pénètre pour la première fois dans un
gouffre, même des plus faciles, on ne saurait
s'entourer de trop grandes précautions et qu'il faut
toujours reconnaître, avec un soin minutieux, les
cavités dans lesquelles on s'engage ; c'est en ne
nous départissant jamais de ce principe, que nous
avons pu mener à bien, sans aucun accident grave,
toutes les explorations, parfois cependant dangereuses, que
nous avons dirigées, ou auxquelles nous avons
collaboré depuis trente ans, dans le Jura, les
Causses, la Provence, les Pyrénées, etc."
|
|

|
|
|
|
|
|
|